« De la présence des Polonais, tout Hongrois se réjouit,
Arrivé hier, tout Polonais est son bon vieil ami. »
(János Arany, « La jeune fille d’Eger »)
« L’histoire n’offre aucun autre exemple de deux nations voisines vivant en aussi bonne intelligence » – affirmait dès 1934 Adorján Divéky, expert distingué des relations internationales de la Hongrie, dans son petit livre qui résume tout ce que les Hongrois ont fait pour la Pologne pendant la Première Guerre mondiale. En conclusion duquel il évoque le tournant de la guerre polono-bolchévique, en août 1920, quand une cargaison de munitions en provenance de Hongrie a contribué à une victoire historique des Polonais – au fameux « miracle de la Vistule ».
Et il est bien vrai qu’il est aisé d’ordonner l’histoire des deux pays dans des récits parallèles.
C’est à peu près à la même époque que nous avons rejoint – par la christianisation et la création d’États – le monde de l’Occidens européen. La date symbolique de 966 que célèbrent les Polonais renvoie à leur conversion au christianisme, tandis que la nôtre, coïncidant avec le tournant du millénaire, est celle du couronnement de saint Étienne. Ces décennies fatidiques trouvent un autre symbole commun en la figure de saint Adalbert (venu du pays des Tchèques), qui, dans les deux pays, a contribué de façon décisive à permettre à la nouvelle foi de s’enraciner. La base de cette communauté de destin est, avant tout, le partage d’une même situation géopolitique, restée, pourrait-on dire, la même des débuts jusqu’à nos jours. Une situation qu’il est d’usage de caractériser par ces mots : à la frontière de l’Orient et de l’Occident. Ce topos né vers la fin du Moyen-âge fait de nos deux pays les antemurale christianitatis, le bouclier de la chrétienté contre les envahisseurs venant de l’Est (Mongols, Tatares, Turcs osmanlis, État moscovite).
Il suffit de jeter un coup d’œil à une carte du milieu du XVe siècle : de la Mer Baltique à la Mer Noire, la confédération polono-lithuanienne – et, de l’autre côté des Carpathes, le Royaume de Hongrie, s’étendant – avec la Croatie – jusqu’à l’Adriatique. Or lors des grandes tempêtes de l’histoire européenne, le vent a le plus souvent soufflé d’est en ouest. Et c’est généralement à cette latitude qu’est passé l’ouragan. C’est d’abord au sud que la muraille de l’Europe centre-orientale a cédé, à Mohács ; ensuite, vers la fin du XVIIIe siècle, au nord, du fait du partage de la Pologne.



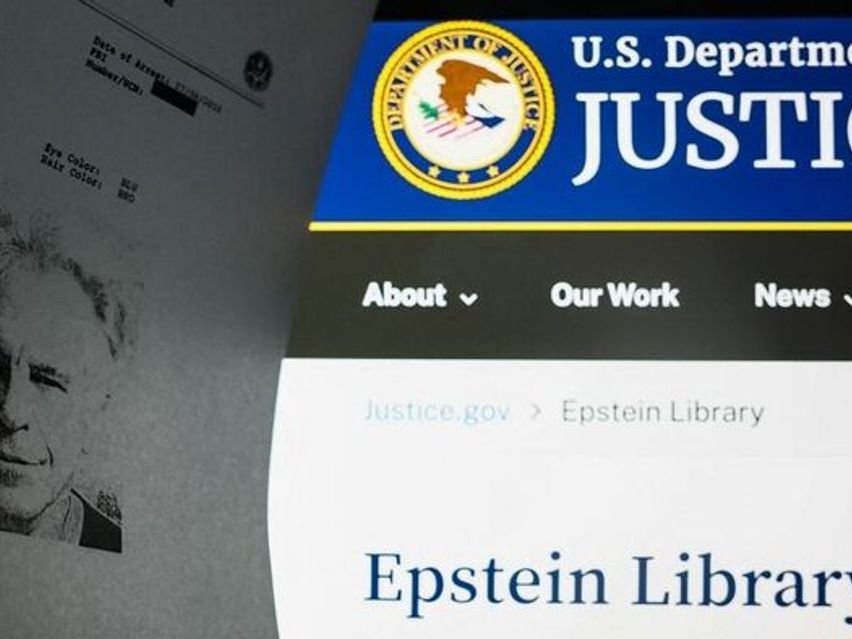











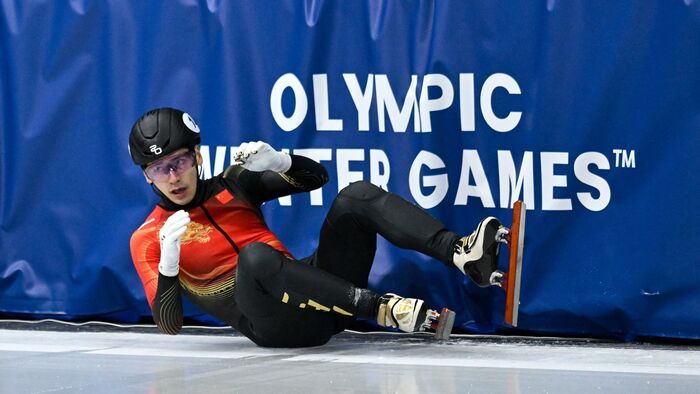



Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!