La double monarchie austro-hongroise (1867–1918), tant dans ses réussites non-négligeables que dans sa chute aux conséquences tragiques peut servir d’exemple aux États multinationaux des époques ultérieures, les aidant à éviter les malheurs qu’elle a vécu, et à persévérer dans les bonnes pratiques qui étaient déjà les siennes. Ses deux centres législatifs – le Reichsrat de Vienne et l’Assemblée nationale hongroise – régnaient sur près de vingt peuples différant les uns des autres par l’origine et par la langue. Leur action politique commune était en pratique limitée à trois domaines : la politique militaire, la diplomatie, et le domaine des finances – un domaine en rapport avec les deux premiers. Les citoyens de cet État – l’un des plus grands d’Europe – circulaient librement de Lemberg [actuellement Lviv en Ukraine – n.d.t.] à Trieste et à Braşov, d’Innsbruck et de Prague à Sarajevo.
La cour impériale s’était vite rendu compte que la coexistence organique de cette diversité ne pourrait être durable que si, par-delà la coopération économique et politique, la conscience de l’appartenance à une patrie commune devenait une expérience spirituelle réellement vécue. L’étude de l’histoire et de la culture (populaire) fut mise au service de la création d’un vécu communautaire au niveau spirituel. Les plus de vingt tomes illustrés de Az Osztrák–Magyar Monarchia [« La Monarchie Austro-Hongroise »], publié en allemand et en hongrois de façon presque simultanée (le rédacteur du texte hongrois fut l’écrivain Mór Jókai), se fixaient pour but « la coexistence harmonique de deux parties dont aucune ne souhaite à l’avenir dénouer les liens les unissant, ni resserrer ces liens, et dont l’épanouissement est fondé sur l’entente mutuelle et la coopération, conformément à la devise de leur souverain suprême : Viribus unitis ! »
Cette tempérance qui caractérisait alors les Habsbourg avait été dictée par le sens des réalités politiques. Elle marqua le début d’un essor culturel sans précédent : la littérature déjà existante (autrichienne, tchèque, italienne, hongroise) entra dans une nouvelle époque, tandis que celle de peuples qui jusque-là disposaient à peine d’une tradition littéraire atteignait en peu de temps des niveaux d’excellence mondiaux. Cependant, la force spirituelle animant les slaves exclus du pouvoir – et notamment les plus dynamiques d’entre eux : les Tchèques – était née sous le signe de la résistance nationale. Quelques mois avant le Compromis austro-hongrois, l’historien et écrivain tchèque František Palacký avait esquissé de la possibilité d’un gouvernement partagé entre Autrichiens et Hongrois, mais excluant les Slaves, une esquisse pessimiste. La proclamation de la double monarchie, avait-il écrit, sera en même temps « le jour de la naissance du panslavisme, sous la forme la moins réjouissante que puisse prendre ce dernier. Nous autres Slaves nous y préparons, avec une juste douleur, mais sans crainte. »
















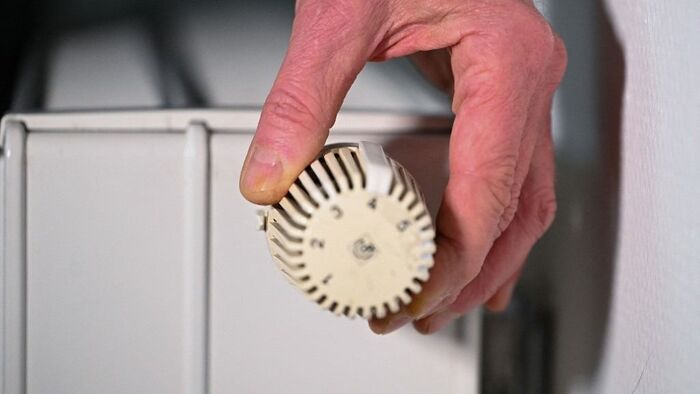

Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!