– Votre dernier ouvrage, publié en 2016, était intitulé A melegházasságról (« Sur le mariage homosexuel »). Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce nouvel ouvrage ?
– J’ai toujours eu dans un coin de ma tête l’idée qu’il faudrait écrire un tel ouvrage, mais, quand j’ai écrit mon livre consacré au mariage homosexuel, je pensais que c’était le dernier livre que je consacrais à ce sujet, et que, à supposer que le besoin de tels textes se fasse sentir en Hongrie, on traduirait tel ou tel titre de la littérature en anglais portant sur ce domaine. Seulement, je n’ai rien trouvé de tel sur le marché. La littérature rédigée en langues de circulation internationale se pose ce problème, mais plutôt à titre d’élément d’une réflexion plus large, comme, par exemple chez Douglas Murray (La grande déraison) ou chez Charles Murray (Human Diversity). Non seulement je n’ai pas trouvé dans la littérature existante de monographie faisant réellement le tour de la question tout en l’abordant d’un point de vue critique, mais je me suis – qui plus est – retrouvé avec beaucoup de matériel en vue d’écrire mon propre texte. Mais l’impulsion décisive m’a été donnée par un article mis en ligne par un portail d’information au cours du second semestre de 2019, consacré à une affaire de transgenres, et dont l’auteur, sur le ton d’un appel à l’aide, se demandait jusque quand il faudrait attendre pour que quelqu’un vienne enfin mettre de l’ordre dans cette histoire. C’est à ce moment que j’ai pris la résolution de tenter, avec un niveau d’exigence scientifique mais dans un langage accessible, d’exposer la structuration des principaux aspects de cette problématique, à l’usage d’un public pouvant inclure des lecteurs qui n’en sont pas familiers, mais aimeraient bien savoir de quoi il en retourne.
– On peut donc dire que votre livre comble une lacune.
– Cela faisait déjà plusieurs années que j’avais l’impression que nous autres, gens de droite, d’esprit conservateur, savons certes tous que l’approche correcte est la nôtre, mais que beaucoup manquent d’assurance dans le débat, étant donné que la partie adverse semble disposer d’arguments de prime abord convaincants, qu’il a d’abord fallu analyser, pour ensuite leur apporter, un par un, notre démenti. Accessoirement, dans toute une série de domaines – allant de l’adoption à la réorientation sexuelle, en passant par le débat « environnement social ou conditionnement biologique ? » –, il n’est pas inutile de prendre connaissance des résultats des recherches scientifiques existantes, qui peuvent fournir de bonnes bases d’argumentation. Au début, c’est un peu sous l’effet d’un sentiment d’indignation que j’ai commencé à m’occuper de cette question : je ne comprenais pas pourquoi nous restons incapables de dire précisément ce qui cloche dans l’idéologie du genre, et j’ai eu le sentiment qu’il fallait combler cette lacune. Bien sûr, cette incapacité est aussi liée au fait que les « savants du genre » s’en prennent souvent aux évidences les plus élémentaires de la vie, et que d’ordinaire, nous autres, gens du quotidien, ne sommes pas obsédés par la défense des évidences. C’est aussi à ce genre d’attaques contre les évidences – souvent capables de nous perturber – que je souhaite répondre par ce livre.





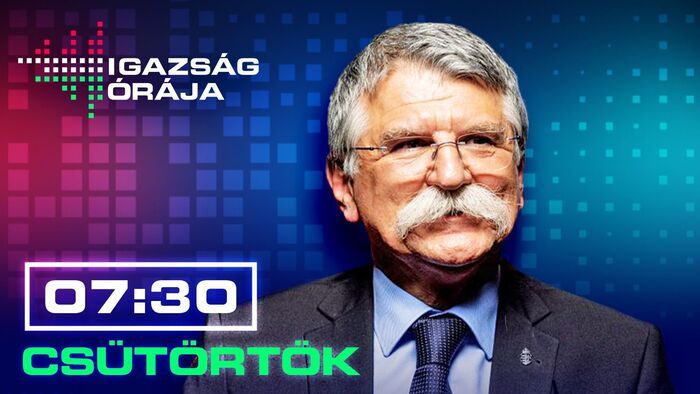













Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!