Hongrois et Serbes écrivent ensemble une nouvelle page de leur avenir commun
Quand bien même peu d’entre nous le sauraient, l’un des monuments architecturaux les plus anciens des relations serbo-magyares se trouve sur l’île [du Danube – n.d.t.] aujourd’hui connue sous le nom de Csepel. L’église du monastère de Ráckeve est l’un de nos monuments gothiques en parfait état de conservation, utilisé depuis 1440 par l’église orthodoxe serbe. C’est Ladislas Premier de Hongrie qui en a fait cadeau aux communautés serbes qui s’installaient dans la région, fuyant les armées turques qui dévastaient les régions bordant le cours inférieur du Danube.
Le fait qu’ici, en plein cœur de la Hongrie, tout au long des quelques six siècles qui se sont écoulés depuis lors, en dépit de tous les revers historiques, de toutes les épreuves traversées par ce pays, une paroisse orthodoxe serbe ait continué à fonctionner sans aucune interruption, cela est pour nous porteur de plusieurs messages d’une grande importance.
En premier lieu, cela nous apprend que la Hongrie n’a pas besoin de donneurs de leçons externes en matière de maintien d’une coexistence interethnique et interconfessionnelle durablement pacifique – et ce, en dépit du fait que, tout au long des siècles écoulés, personne n’ait éprouvé le besoin d’accoler une étiquette de « multiculturalisme » à cette coexistence pacifique.
Autre leçon d’une grande importance : l’histoire des relations serbo-magyares est riche d’une longue tradition d’entraide face à des périls existentiels comme celui qu’a représenté la conquête ottomane en Europe du Sud-Est. Ce message est de nos jours d’une grande actualité, au moment où nos pays sont menacés par des défis aussi sérieux que l’épidémie de coronavirus ou le danger de l’immigration de masse. Ce dernier est, bien entendu, d’une autre nature que celui que Hongrois et Serbes ont eu à affronter il y a six cents ans, mais lui aussi représente un grave risque sécuritaire, et nous arrive – comme à l’époque – du Sud-est.















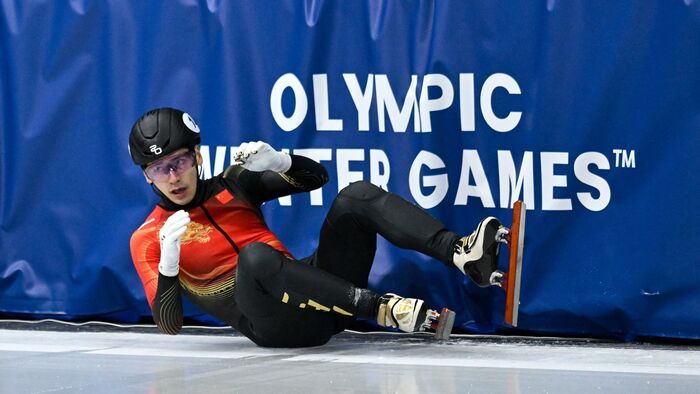



Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!